

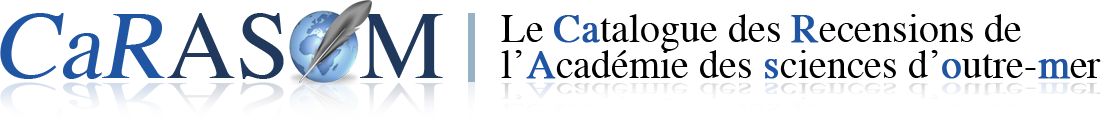
| Auteur | Julie d'Andurain |
| Editeur | Perrin |
| Date | 2022 |
| Pages | 509 |
| Sujets | Gouraud, Henri (1867-1946)
France Armée Troupes coloniales Officiers Guerre mondiale (1914-1918) Opérations militaires |
| Cote | 67.016 |

Bien oublié aujourd’hui, Henri Gouraud (1867-1946) fut une des grandes figures militaires de son temps. Ses titres à la notoriété, voire à la gloire, avaient été nombreux : vainqueur du grand chef africain Samori en 1898 ; plus brillant lieutenant de Lyautey au Maroc en 1911-1912 ; mutilé aux Dardanelles en 1915 ; commandant une armée sur le front de Champagne, dans les journées décisives de l’été 1918, puis premier général français à entrer à Strasbourg quelques jours après l’armistice du 11 novembre ; Haut-Commissaire au Levant (Syrie-Liban) de 1919 à 1922 ; et finalement gouverneur des Invalides (1922-1939). Toutes ces étapes sont retracées avec précision dans la biographie rédigée par Julie d’Andurain, mais celle-ci a mis à profit, outre sa familiarité avec la bibliographie du sujet, une connaissance inégalée des archives publiques (Armées, Affaires étrangères, Colonies) et l’accès aux fonds privés de Gouraud, pour aller bien plus loin que la simple description détaillée d’une carrière. Cette carrière prend en effet tout son sens à être replacée au sein de la société politique et militaire du temps qui ne cesse jamais de susciter des choix et d’imposer des contraintes, et apparaît ainsi, très largement, comme le sujet du travail. À travers ces pages, tout un réseau de relations se trouve reconstitué, comme en témoigne la richesse de l’index des noms propres.
Qu’est-ce qui a fait la supériorité de Gouraud, outre, bien évidemment, une intelligence formée par l’éducation bourgeoise de son temps, et orientée par l’enseignement reçu à Saint-Cyr, et complété plus tard à l’École de Guerre ? Le courage physique, il va de soi, qui le fait marcher quand il le faut à la tête de ses hommes. Une santé soigneusement entretenue, avec laquelle il peut affronter dans sa jeunesse les forêts tropicales, puis les déserts sahariens, et qui l’aide à se rétablir en quelques mois des terribles blessures de 1915, qui le laissèrent amputé de l’avant-bras droit. Il convient surtout de souligner ses qualités d’organisateur qu’il commence à démontrer quand il s’agit d’ouvrir et entretenir les routes des étapes destinées à ravitailler les petits postes africains, et qu’il déploie à fond lors de la Grande Guerre, pour organiser les lignes de défense destinées à faire face à l’ultime offensive de Ludendorff. Il sait aussi s’insérer dans un milieu favorable, en se ménageant très tôt un solide réseau, et tout d’abord au sein du « parti colonial » (sur lequel Julie d’Andurain a publié un ouvrage important, Colonialisme ou impérialisme ? Le parti colonial en pensée et en action, 2017). Il se fait apprécier notamment du cacique Eugène Étienne, puis de Gallieni et de Lyautey. On loue sa prudence, qui lui évite d’engager ses troupes dans des « affaires » hasardeuses qui pourraient discréditer les projets d’expansion. On a de la considération pour sa modération politique qui lui assure une réputation de républicain loyal, catholique convaincu, mais discret, notamment lors de l’affaire Dreyfus, à l’occasion de laquelle son nom n’est même pas cité. Par ailleurs, la renommée de Gouraud dépasse largement le milieu colonial. Sa bonne éducation et sa courtoisie en font une figure prisée de la société mondaine ; son humanité lui confère une indiscutable popularité chez ses soldats. Au-delà, beaucoup de ses compatriotes, voire d’étrangers, notamment les Américains, dont il accueillit les premiers contingents dans son armée, éprouvent émotion et admiration à l’égard du « glorieux mutilé », vivante image du sacrifice des « Poilus » victorieux.
Comme Haut-Commissariat au Levant, Gouraud montre des qualités certaines. Éloigné d’un impérialisme étroit, il semble avoir vraiment voulu bâtir une grande Syrie. La rupture avec le roi hachémite Faycal qui met fin à ce projet, serait, d’après Julie d’Andurain, plus le fait du gouvernement d’Alexandre Millerand que de Gouraud lui-même, soucieux d’éviter les conflits autant que faire se peut. C’est pour protester contre le manque de moyens nécessaires au nouveau Mandat qu’il demande son départ. Sa fin de vie, couverte d’honneurs, manifeste cependant la sclérose qui saisit les grands chefs de l’armée après 1918 : les tournées prestigieuses de Gouraud aux États-Unis ou en Europe centrale et balkanique sont de peu d’effet pratique pour resserrer des alliances efficaces, et il ne manifeste aucune réflexion stratégique ou tactique en vue de préparer une guerre qu’il sent pourtant approcher. Sa mort marque la fin d’une génération qui a su préparer la revanche de 1870 sans pouvoir chercher au-delà, peut-être pour être sortie épuisée d’un trop grand effort. L’effacement de Gouraud est d’autant plus grand que, à l’exception de souvenirs tardivement parus sur les débuts de sa carrière africaine, il n’a pas laissé d’écrits qui s’imposeraient, comme par exemple la Force Noire de Mangin, devenue une référence obligée, avec tous ses excès. Il a plutôt appliqué, avec beaucoup d’intelligence, les doctrines élaborées par d’autres (Gallieni en matière coloniale, Pétain en matière de grande stratégie) qu’il n’a été un novateur en ces matières.
En résumé, Julie d’Andurain a su rédiger un livre sans doute indépassable sur Gouraud, saisi dans son milieu et en son temps. Mais son travail va sans doute plus loin que ne le suggère la modestie de son auteur. En analysant systématiquement les différentes questions qu’il fut donné de connaître à ce soldat : pratique de la politique coloniale, adaptation à un conflit de très haute intensité, rapports avec le pouvoir civil, voire détention de pouvoirs civils, elle donne l’exemple de ce que peut et doit être une véritable histoire militaire dégagée des présupposés et des appartenances partisanes.