

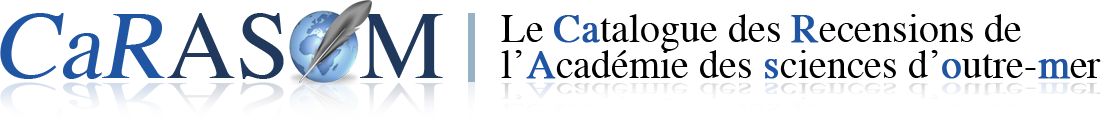
| Auteur | Jean-Luc Vellut |
| Editeur | Karthala |
| Date | 2021 |
| Pages | 515 p. |
| Sujets | Congo (République démocratique) 1885-1908 Congo (République démocratique) 1908-1960 |
| Cote | 66.081 |
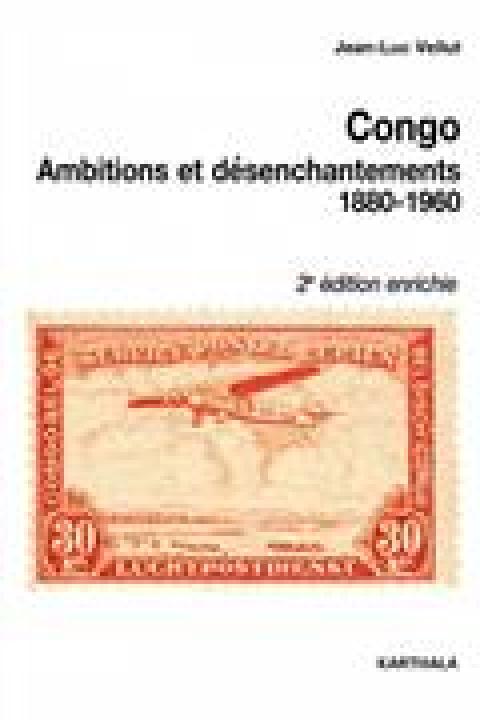
Le recueil de plus de soixante-dix articles publié par Jean-Luc Vellut, académique belge de renom, constitue le témoignage prolifique d’une connaissance approfondie du Congo ex-belge. Celle-ci fut acquise sur le terrain où il enseigna entre 1964 et 1976, avant de poursuivre sa carrière de professeur à l’Université de Louvain. Ses écrits dont les premiers datent de 1965, témoignent de son constant intérêt pour cette partie de l’Afrique. La valeur de ces travaux a d’ailleurs été reconnue par l’Africa Museum - Musée royal de l’Afrique centrale de Tervuren, la Fondation Louvain, ainsi que l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer, homologue belge et partenaire de l’ASOM, qui ont permis la publication de cette somme de plus de 500 pages.
Durant toutes ces années, l’auteur prétend avoir évité les caricatures et les jugements de valeur clivants portés sur cette période, sans céder à la nostalgie ni aux idées indigénistes en vogue à l’heure actuelle. Nous verrons si cela a été vraiment le cas et si ces textes traduisent véritablement cette intention.
Les articles repris dans cet ouvrage se répartissent en cinq chapitres, en passant du global au local ; du « Grand jeu », expression popularisée par Rudyard Kipling, appliquée par extension à l’Afrique de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe, à l’humain, à son statut et à ses croyances, sans oublier les regards croisés des Européens et des Africains.
La première partie est intitulée : « État du Congo, État conquérant, État de transition ». Elle traite classiquement de façon chronologique, du contexte international de l’époque, du rôle personnel du roi Léopold II, des personnages qui l’ont conseillé, ainsi que de ses « grandes espérances » concernant cet immense territoire. Pendant la période léopoldienne, l’unicité du statut de l’association internationale du Congo (AIC) puis de l’État indépendant du Congo à partir de 1885 résidait dans son statut qui se rapprochait d’une compagnie à charte de l’Ancien régime, soutenue par des intérêts commerciaux et des banques.
Le second chapitre intitulé le « grand désordre de 1880 à 1920 » est assez innovant car il va à l’encontre de l’image classique d’une conquête purement européenne de territoires habités exclusivement par des indigènes unis contre l’envahisseur. Jean-Luc Vellut nuance cette vision binaire et fait intervenir d’autres acteurs comme les Arabes, les Afro-Arabes, liés à la traite négrière, ainsi que les Angolais. Il met en lumière les dissensions entre tribus et clans africains qui n’hésitent pas à se faire la guerre ou à l’occasion à s’allier aux Arabes ou aux Européens. Il en va de même pour l’obsession de Léopold II consistant à marcher sur les sources du Nil au Soudan, en s’alliant aux chefs des dynasties Bandia ou Voungara. L’auteur mentionne bien qu’il y eut de nombreuses luttes fratricides, des seigneurs de guerre ainsi que des violences réciproques, faits bien souvent ignorés volontairement par les tenants d’une histoire exclusivement à charge.
Dans les deux parties suivantes, l’auteur passe du global au local.
De la troisième : « Malaises coloniaux », on retiendra principalement l’histoire des « résistances », concept provenant de l’histoire européenne au cours de la seconde guerre mondiale, qu’elles soient réelles ou fantasmées. Les premières, (1879 – 1884) furent le fait de commerçants rivaux africains ou européens. Ces révoltes « primaires » achevées, d’autres prirent le relais en différents points du territoire (1910 – 1925). Enfin, des réformes profondes, dont le décret sur les « circonscriptions indigènes » et la réforme de l’impôt ont entrainé des jacqueries, des affrontements silencieux de la part des ouvriers et même des mutineries parmi les soldats. Comme le souligne Jean-Luc Vellut, la plus documentée est celle de la Force publique, dirigée contre le colonisateur en juillet 1960. La contestation globale et organisée du système colonial fut le fait de mouvements chrétiens noirs, avec le personnage emblématique de Kimbangu (qui sera développé dans la 4e partie) et d’une brève prise de conscience du nationalisme congolais (1919-1921) de la part d’intellectuels influencés par les afro-américains Marcus Garvey et W.E.B Du Bois. Et l’auteur de légitimement s’interroger : « Au terme de ce parcours hétéroclite, est-il possible de dégager une image des résistances à l’occupation coloniale ? »
La détresse matérielle et la découverte de la misère dans les territoires belges d’Afrique, dues aux épidémies, au dépeuplement et aux disettes, non imputables au colonisateur sont également passées en revue, mais sans être vraiment différentes de celles qu’ont connu et que vivent encore aujourd’hui certains pays « en développement » qu’ils aient été colonisés ou non.
La quatrième partie : « Comment rêver l’âme du Congo » plonge le lecteur dans les Congolais au plus profond de leur être. Nous pénétrons dans leur mode de vie, leurs croyances ancestrales, leur rencontre avec la culture européenne, notamment la religion catholique. Jean-Luc Vellut étudie en détail comment christianismes d’Europe et d’Afrique se sont rencontrés et mêlés. Enfin, l’entrée dans le « roman national » de Simon Kimbangu et sa pensée radicale sont longuement évoquées. Celle-ci, d’origine populaire ancrée dans la conscience kongo fut « mise en forme ensuite par le jeu des institutions religieuses d’abord et politiques plus tard. Elle aboutit à faire de Kimbangu une figure centrale de la nation congolaise en devenir ». Les tenants de l’évolution vers l’indépendance dans les années 1920, notamment le parti communiste belge, étroitement lié au Komintern, s’évertuèrent et réussirent à en faire « un héros du mouvement révolutionnaire international ». Mais la stratégie stalinienne de « front rouge » effectua un revirement dans les années 1934-1935 afin d’imposer le « front populaire ». Il fallut attendre la veille de l’indépendance pour que les communistes redeviennent présents sur la scène du kimbanguisme. Thaumaturge, prophète, martyr chrétien ? Si la question peut être légitimement posée, les interprétations de l’essence même de ce personnage complexe dépendent des sources à la disposition du chercheur qui sont diverses et parfois orientées.
L’ultime partie : « Rideaux sur un temps colonial » change de méthode pour revenir à une étude chronologique et plus globale, à travers l’évolution de la colonie de 1920 à 1960. Elle décrit l’état du monde et du Congo, aux plans politique, économique et des relations entre les différents groupes raciaux qui le peuplaient. Jean-Luc Vellut distingue trois périodes :
La première : « 1920-1939 : Avancées, anxiétés et replâtrages dans la construction du Congo » débute par une analyse de l’activité économique de cet immense territoire. L’auteur met en évidence le fait que, contrairement au reste de l’Afrique centrale, le Congo belge a vu l’industrie minière fortement capitalisée représenter environ 60% de son commerce extérieur. Bien que dominant, ce secteur ne pouvait faire oublier l’importance de la production agricole, essentiellement d’huile et de coton, émanant de petits producteurs africains qui cohabitaient avec des complexes agro-agricoles modernes.
La structure de l’économie de la colonie se verra fortement perturbée par la crise de 1929, avec l’effondrement des cours mondiaux des matières premières. Ce nouveau contexte entraina une intervention de l’État qui infléchit la composante minière des échanges extérieurs au profit de l’accroissement important des productions agricoles commercialisées. D’une façon générale, la préoccupation consistait à ouvrir la masse de l’économie africaine à l’économie de marché, que les acteurs soient locaux ou extérieurs. Mais la gestion de ce passage à l’âge industriel ne se fit pas sans conséquences sociales, entraînant inévitablement revendications et soulèvements d’une partie des populations indigènes. En réaction à ce contexte explosif, l’alliance entre l’État et l’Église catholique, composante du régime léopoldien, fut réévaluée. Cette dernière changea plusieurs fois de cap, en tentant de faire évoluer l’Église missionnaire vers le monde moderne. En effet elle était prise entre deux exigences pas toujours compatibles : d’une part préconiser une doctrine sociale visant à améliorer le sort des indigènes et d’autre part conserver une idéologie anticommuniste.
La seconde période (1920-1940) sera celle qui verra apparaitre le spectre du dépeçage du Congo belge par les grandes puissances européennes, notamment soucieuses d’éloigner l’Allemagne nazie de ses ambitions de conquêtes en Europe. Pendant l’occupation de la Métropole par l’Allemagne, le Congo belge tenta de survivre comme il pouvait, au gré de l’évolution du conflit en Europe.
Puis, la nouvelle donne issue de la fin du second conflit mondial bouleversa les équilibres planétaires, avec l’apparition de deux puissances majeures : les États-Unis d’Amérique et l’Union soviétique, au détriment des pays colonisateurs européens épuisés par quatre années de guerre. Comme d’autres, la Belgique fut tentée par le statu quo ante, sans tenir compte des aspirations de nombreux congolais à participer à la gestion de leurs propres affaires. Pourtant sans envisager l’indépendance proprement dite, le discours de Brazzaville du général De Gaulle avait ouvert la voie à une nouvelle dévolution du pouvoir dans les colonies africaines. Des expériences de décentralisation associant progressivement les peuples coloniaux à « la gestion de la chose publique dans leur pays », ainsi que des réflexions autour d’une économie africaine autonome avaient été tentées. Mais il était déjà trop tard et la prise de conscience trop tardive des réalités conduisit la Belgique à hâter l’octroi de l’indépendance au Congo sans véritable préparation. Les conséquences de cette décision engendrèrent des troubles graves qui ont même donné naissance à un néologisme : la « congolisation ».
Que retenir de cette suite d’articles très fouillés d’un académique qui nous livre dans cette publication l’essentiel de ses recherches échelonnées sur près d’un demi-siècle ? Si l’on se réfère aux académiques qui présentent les travaux de Jean-Luc Vellut : « …le lecteur sera frappé par l’absence d’une grande synthèse de l’histoire du Congo ». Nous souscrivons à cette analyse, mais la connaissance quasi encyclopédique de ce pays peut en être l’explication, tant l’auteur rentre dans le détail des sujets qu’il traite et maitrise à la perfection.
Pour notre part, nous tenterons de répondre à la question de la neutralité affichée par Jean-Luc Vellut dans son introduction. Effectivement, sa présentation des évènements est relativement équilibrée et en rupture avec l’Européocentrisme. Il reconnait d’ailleurs lui-même que la colonisation de ce territoire ne peut pas être vue uniquement en noir et blanc, sans tenir compte de l’époque où les faits se sont déroulés. Ce qui constitue à l’évidence, le rejet de l’anachronisme qui caractérise trop souvent les publications sur la colonisation depuis des décennies.
Selon nous, quelles qu’aient été les intentions louables d’équilibre revendiquées par l’auteur, il manque indéniablement des développements faisant état de l’héritage laissé par les Belges à la fin de ces 80 ans de présence. Celle-ci ne peut pas se limiter au caractère brutal, égoïste et cupide d’un pays européen au détriment de populations disséminées sur un territoire immense et décimées par des guerres interethniques et des épidémies bien avant le « Scramble for Africa » des Européens. Sans réfuter en aucune façon les critiques qui peuvent être faites à l’intrusion de l’Europe en Afrique, force est de constater que la République démocratique du Congo d’aujourd’hui est entrée dans la modernité grâce à cette période honnie de la colonisation. Les ponts, les barrages, les hôpitaux, les routes, l’électricité, l’exploitation des richesses minières et agricoles sont des acquis qui ont permis aux Congolais, souvent au prix de privations et de traitements inqualifiables, de pouvoir aspirer à une vie meilleure. Soixante ans après l’indépendance, la grille de lecture consistant à faire porter la responsabilité de la situation actuelle du pays, uniquement sur le colonisateur est essentiellement idéologique. Elle permet à peu de frais aux dirigeants qui se sont succédés depuis 1960, à part lorsque Moise Tshombe fut Premier ministre (1964-1965), de s’exonérer de toute responsabilité dans l’état actuel du pays et de ses habitants.
Nous devons être redevables à Jean-Luc Vellut qui a essayé, grâce à une connaissance parfaite du Congo, de rétablir un certain équilibre dans le jugement porté sur cette période de la colonisation belge, ce qui n’est pas aujourd’hui chose aisée.